NUMÉRO 1 : LE VIDE
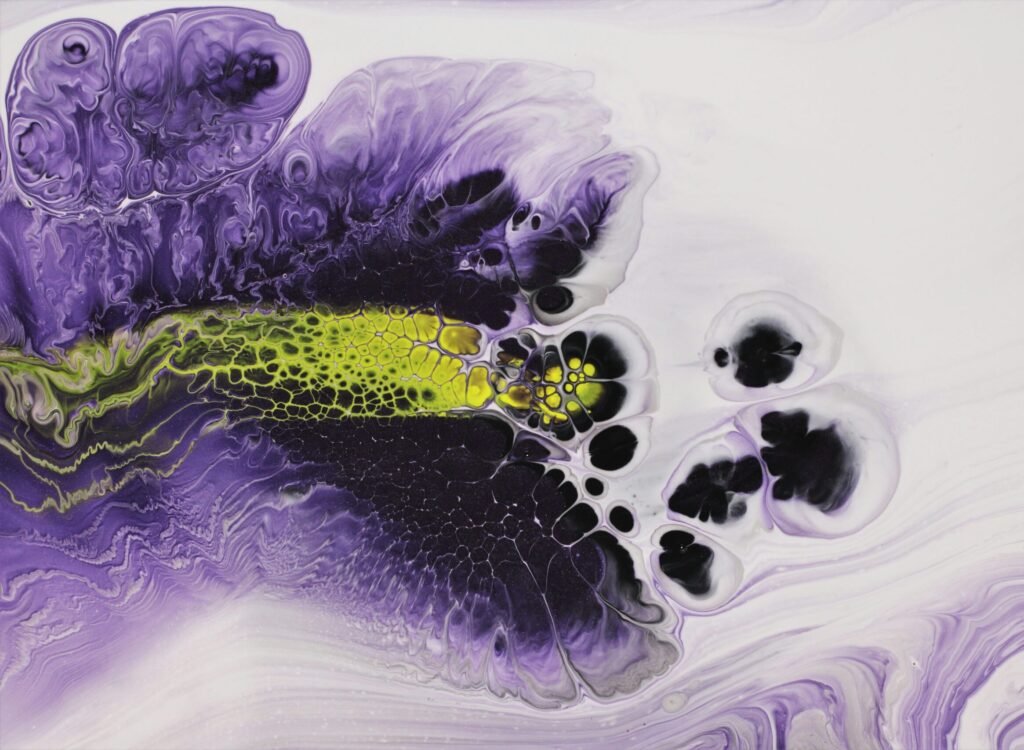
MINORITÉS ET NON-CONFORMITÉ DE GENRE : LE VIDE COMME RÉSISTANCE
ANALYSE
CLÉMENCE FAU
Le 11 septembre 2023, une pétition « Supprimez la loi Evras ! » est lancée pour demander au ministre de l’Éducation nationale qu’il « réagisse sur sa loi et la retire ». Une certaine « Nadou G » explique dans une vidéo massivement diffusée sur les réseaux sociaux que « Leur projet est d’aller parler à des maternelles dès 5 ans. […] On va dire à des enfants : “Alors petit garçon, tu te sens pas peut-être un petit peu fille ? Mais ne t’inquiète pas, c’est normal, peut-être que tu vas te transformer en fille.” Ils veulent faire de nos gamins des trans. ». Quatre écoles sont même incendiées et vandalisées à Charleroi dans la nuit du 12 au 13 septembre. Ce déferlement de colère et de haine est la conséquence d’une large désinformation : cette « loi » d’une part n’en est pas une (il s’agit d’un guide d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle pour les professeurs), et ne concerne pas la France mais la Belgique. Ce n’est ni la première, ni la dernière fois que l’argument de la protection des enfants est dégainé afin de justifier l’agenda politique de l’extrême droite et de groupes et associations conservateurs. Les discours transphobes sont en hausse depuis quelques années : il n’y a qu’à voir l’influence de J.K. Rowling¹ dans l’opinion publique anglo-saxonne, les influenceuses et associations françaises qui se revendiquent « féministes » (mais défendent seulement les femmes avec un vagin), l’interdiction de la Pride à Budapest en 2025…
La non-conformité de genre a toujours gêné, toujours été stigmatisée. Les stéréotypes et les campagnes de désinformation sont des outils privilégiés pour empêcher toute tentative de déroger aux normes strictes binaires homme/femme, et pour faire plus facilement des persones minorisées d’énièmes « étranger·e·s » rejeté·e·s aux marges de la société. Dans un contexte de montée mondiale du fascisme, il n’est pas anodin de voir ce genre de discours prendre de l’ampleur, car les minorités et la non-conformité de genre transgressent l’ordre binaire strictement établi et sont un moyen disruptif de résistance et d’émancipation.
LE SYSTÈME BINAIRE, UN OUTIL D’OPPRESSION AU SENS LARGE
Pourquoi la binarité, le sexe, le genre, sont-ils devenus les modèles définitoires des rapports sociaux ? Les normes de genre qui structurent notre société sont loin d’être naturelles : elles sont politiques. Le 6 mai 1933, un des premiers autodafés du régime nazi prend pour cible l’institut de sexologie de Berlin, haut lieu de recherches pionnières sur le genre. La question du genre n’a jamais été neutre, et elle n’a jamais été une vérité absolue. Le système binaire, quant à lui, relève d’une volonté de contrôle et d’uniformisation des corps. Car si l’on maintient l’idée que le genre est cloisonné au sexe, défini par l’apparence physique, et par nos corps, alors celui-ci ne nous appartient plus. Il appartient au gouvernement, aux autorités médicales, aux industries pharmaceutiques et de la mode qui nous dictent comment nous déguiser pour avoir droit à une place dans la société.
En effet, l’organisation binaire et genrée de la société n’est pas naturelle, mais tout à fait intentionnelle et institutionnelle. Selon les mots de Paul B. Preciado², « le régime sexe-genre binaire est au corps humain ce que la carte est au territoire : un cadre politique qui définit organes, fonctions et usages.». Il organise la force de travail, la médecine, la nation, les structures familiales, les modes de socialisation, et assure leur pérennité. Il permet au capitalisme de garantir la reproduction d’une force de travail stable et le maintien de l’économie du pays grâce à une légion de consommateurs avides d’une place sûre et privilégiée au sein de la société. Il n’est pas anodin que dans le contexte de crise actuelle, le président parle de « réarmement démographique ». La Cour suprême du Royaume-Uni statue que la définition de la femme est « une personne née biologiquement de sexe féminin³ ». Donald Trump, à peine élu cette année, émet un décret nommé « Gender Order » qui met en arrêt toute demande de changement de sexe pour les titres d’identité des citoyens américains et la suppression de l’option de genre X⁴. D’une pierre deux coups, ils désignent un bouc émissaire – les personnes queer, trans, homosexuelles, dont le genre et la sexualité défient les normes et les impératifs de reproduction hétérosexuelle contrôlée – et relancent la campagne de régénération de leur base de consommateurs.
En réaffirmant dans les politiques récentes la stricte partition sociale du sexe-genre binaire, les gouvernements encouragent aussi la mise en avant de modèles de masculinité et de féminité très précis. Les mouvements tradwife et masculinistes sont en plein essor sur internet : ils promeuvent le retour de la femme au foyer, soumise à un mari travailleur, réduite aux fonctions de soin marital et de reproduction. On “accuse” des athlètes cis de transidentité lors des JO car trop musclées ou trop performantes. Des femmes cis sont exclues des toilettes publiques au Royaume-Uni car suspectées d’être des hommes, à cause de leurs cheveux trop courts ou de leur poitrine trop petite. La réaffirmation d’une stricte binarité mène à la résurgence de modèles de genre poussés à l’extrême, caricaturaux, qui oppressent et pathologisent non seulement les personnes trans, non-binaires, homosexuelles ou handicapées, mais aussi les personnes cis, hétérosexuelles, valides. Alors les entreprises pharmaceutiques, les cabinets de chirurgie esthétique, les marques de mode et de produits de beauté peuvent commencer leur entreprise de capitalisation. Une panoplie de solutions sont mises à disposition afin de corriger chacun de nos défauts, notre insuffisance génétique, notre dysphorie de genre – à condition d’y mettre le prix. Car oui, peu importe notre genre, qu’il nous ait été assigné à la naissance ou non, lorsqu’on se sent mal dans sa peau – pas assez belle, pas assez viril, pas à la hauteur du modèle d’homme ou de femme qu’on nous a vendu – c’est de la dysphorie de genre. Le capitalisme mise sur l’impossibilité d’atteindre cette binarité stricte mais idéalisée. Plus le malaise sera grand, plus la hausse de la consommation sera conséquente.
Dans un contre-son-camp magistral, ceux qui veulent à tout prix conserver la pureté du genre prouvent par là même que cette binarité stricte n’est pas effective. En effet, la chasse aux sorcières trans dont les retombées menacent aussi les femmes cis, ainsi que la quête de l’essentialisme ultime du genre par la promotion de “solutions miracles”, sont bien la preuve qu’aucune personne cis ne pourra jamais l’être assez. L’obsession de pureté binaire nous affecte tous, nous oppresse tous. Elle vise le contrôle de tous les corps – pour maintenir l’ordre, maintenir le système, l’économie, la nation, l’industrie pharmaceutique… En somme, il s’agit de préserver la structure normative d’une société dont le modèle est considéré comme unique, le seul à être fonctionnel, ou du moins, le plus développé. Un discours qui glisse avec une facilité inouïe vers une rhétorique suprémaciste et fasciste.
C’est aussi ce qui fait du modèle binaire un des grands outils de la colonisation, et ce qui lui a permis de devenir le système dominant à l’échelle mondiale. Nombre de sociétés comprenaient un troisième genre (voire plus), qui jouait le plus souvent un rôle fondamental dans la vie spirituelle, les soins et la santé de ces sociétés. Cependant, elles ont été largement détruites lors du processus de colonisation et d’évangélisation qui a imposé ce modèle autoritaire au cœur du processus de “civilisation” des populations locales. Certaines subsistent encore aujourd’hui (les Muxes au Mexique, les hijras en Asie du Sud, les two-spirit chez les communautés autochtones nord-américaines), mais elles sont devenues minoritaires, invisibilisées. Le plus souvent, elles ne sont pas reconnues par le gouvernement de leur pays et largement discriminées.
Or le modèle binaire a un impact beaucoup plus large que les simples normes de genre : il est un système de pensée. Il nous pousse à structurer le monde autour de nous en oppositions : homme/femme, homme/animal, bon/mauvais, force/faiblesse, logique/émotion, moi/l’autre, eux/nous, civilisation/sauvagerie. Des diptyques qui structurent encore à ce jour la rhétorique néocoloniale et suprémaciste blanche.
C’est justement pour cette raison que la non-conformité de genre est invisibilisée, voire diabolisée : parce qu’elle remet en question cet ordre établi du genre, et par extension de toute notre société. En réinterrogeant le rapport au corps et en le décorrélant du genre et du sexe, la non-conformité court-circuite les rôles sociaux. Elle cristallise les discours misogynes, homophobes et racistes qui accompagnent cette structure binaire de la société. Elle montre que malgré les victoires acquises en termes de droits sociaux, les luttes pour l’égalité s’inscrivent toujours dans une architecture de pouvoir inchangée, où les privilèges restent entre les mains des hommes blancs, cisgenres et hétérosexuels.
HORS DES NORMES DE GENRE
La non-conformité de genre s’inscrivant par définition en-dehors de la structure hétéro-patriarcale, il faut aller explorer ce qui se trouve au-delà du système établi. Lorsqu’on s’éloigne de ces carcans rigides, on ne se retrouve pas plongé dans le néant, dans le flou absolu ; on découvre au contraire une grande richesse, qu’elle soit celle des cultures autochtones ou celle de la culture queer occidentale.
Bien que nos sociétés nous matraquent d’un modèle autoritaire hétéronormé, la culture queer n’a jamais cessé d’inventer de nouvelles façons d’aborder les différents vécus du genre. La multitude des identités queer en atteste : trans, non-binaire, ainsi qu’une variété de catégories plus précises qui dévoilent des expressions de genre nombreuses et mouvantes. Transmasc, une personne trans qui adhère à une expression de genre masculine. Transfemme, une personne trans qui adhère à une expression de genre féminine. Demiboy ou demigirl, un genre dans lequel on est partiellement, mais pas entièrement, d’un genre binaire, et qui peut aussi se combiner avec n’importe quel autre genre ou combinaison de genres, y compris une absence de genre. Même au sein d’un genre plus binaire, il existe un certain gradient, une certaine fluidité, qui atteint son paroxysme dans l’identité genderfluid, désignant une personne dont l’identité de genre fluctue au fil du temps. Elle peut varier de manière aléatoire ou en réponse à différentes circonstances, changer au fil des heures, des jours, des mois ou des années. Une personne genderfluid peut s’identifier à n’importe quel genre ou combinaison de genres à un moment donné, et peut fluctuer entre une poignée de genres ou un plus grand nombre.
Parmi la variété des identités possibles, celle qui se rapproche le plus de cet a priori de la non-conformité de genre comme vide flou et informe serait l’identité agenre, ou gendervoid, un micro-label de la non-binarité. Les personnes gendervoid définissent leur expérience comme une absence, un espace vide où le genre existerait pour les autres mais ne s’exprime pas chez eux. D’autres se disent incapables de vivre l’expérience d’un genre, ou considèrent le vide lui-même comme la structure de leur identité. Ce qu’il y a d’intéressant dans ces deux notions, c’est qu’il est possible pour certaines personnes de mener une existence dépourvue d’expérience de genre. En ce sens, le vide de genre cesse d’être un flou issu de préjugés ou d’une incompréhension, et devient un acte de résistance. Jana Funke, dans son article de 2012, « Obscurity and Gender Resistance in Patricia Duncker’s James Miranda Barry », explique que l’obscurité autour du sexe ou du genre de certaines figures historiques est une forme de résistance aux normes de genre. Elle prend en exemple le docteur James Barry, chirurgien militaire de l’armée britannique au XIXe siècle, qui a été interprété tour à tour par les historiens comme un homme trans, une femme travestie ou une personne intersexe. En effet, le besoin irrépressible de connaître le sexe assigné à la naissance, de ranger dans une case nette les figures historiques relève d’un impératif normatif de classification. Le vide, le négatif, l’absence, par leur caractère indéfinissable, deviennent donc des potentiels libérateurs, vivants.
Or, comment gouverner le vide ? C’est exactement ce qui rend les personnes queers dangereuses aux yeux de ceux qui souhaitent le maintien de l’ordre social actuel : lorsqu’on est indéfinissable, on devient aussi insaisissable, ingouvernable.
La révolution queer ne propose pas seulement de nouvelles catégories ou classifications, mais la possibilité de changer, d’évoluer au cours du temps et d’une vie. Surtout : il n’y a pas de règles. Les termes d’homme, femme, non-binaire ou autre ont moins vocation à s’envisager comme une boîte dans laquelle on s’enferme, mais comme un badge ou une étiquette, susceptible ou non de changer. On peut en piocher un, changer d’avis et en piocher un autre. Choisir un badge préexistant, ou en inventer un nouveau. Ils sont un moyen de communiquer notre vécu, notre ressenti, et de le partager avec d’autres. Ils reviennent finalement à leur essence grammaticale et linguistique : un nom, un élément de langage. Un outil de communication et de socialisation. Une façon pour nous de raconter notre expérience. Il n’y a pas d’attente d’un physique particulier, d’une attitude particulière, d’une façon de s’exprimer. Ce qui compte, c’est que l’on se sente bien, que l’on se sente soi-même. Le fait de s’y identifier est un ajout, une nuance qui enrichit pour chacun·e la définition du terme.
La penseuse anarchiste américaine Emma Goldman écrit en 1940 que « l’homme vivant ne peut pas être défini ; il est source de toute vie et de toutes valeurs, il n’est pas une partie de ceci ou de cela ; c’est un tout, un tout individuel, un tout qui évolue et se développe, mais qui reste cependant un tout constant.⁵». En ce sens, ne serait-ce pas l’ultime accomplissement de soi que d’accepter que notre identité de genre, au même titre que tout autre aspect de notre personne, est vivante, mouvante, et en constante évolution ? Parce qu’elle est nôtre, elle est justement indéfinissable autrement que par notre façon de la vivre. C’est l’ultime acte d’amour, de respect de soi et des autres que de se libérer des normes de genre, d’accepter ce vide comme quelque chose de positif, libérateur, et prospère.
Autrice de la série Harry Potter, désormais milliardaire, J.K. Rowling s’illustre tristement par ses positions transphobes depuis cinq ans. Le 10 juin 2020, face à la dénonciation de plusieurs de ses tweets transphobes, elle publie sur son blog un essai dans lequel elle présente « Cinq raisons de s’inquiéter du nouveau militantisme trans » (Les Inrockuptibles, « J.K. Rowling s’explique après ses propos transphobes (et s’enfonce) », Faustine Chevrin, 11 juin 2020). Elle a depuis drastiquement radicalisé ses positions, a créé cette année un fonds privé destiné à soutenir des décisions juridiques transphobes (Libération, « Voldemort. Transphobie : la créatrice milliardaire de Harry Potter J.K. Rowling alimente un fonds contre les personnes trans », 4 juin 2025) et s’acoquine avec des « féministes » britanniques controversées et souvent proches de l’extrême droite, comme la militante anti-trans et essentialiste Posie Parker.
Paul B. Preciado, Je suis un monstre qui vous parle, 2020, Grasset.
La Déferlante, « Droits des personnes trans : le Royaume-Uni dans la confusion », Élie Hervé, 12 juin 2025.
BBC News, « Trump makes ‘two sexes’ official and scraps DEI policies », Mike Wendling et Kayla Epstein, 20 janvier 2025.
Emma Goldman, L’Individu, la société et l’État, 1940, Chicago, Free Society Forum.
