NUMÉRO 1 : LE VIDE
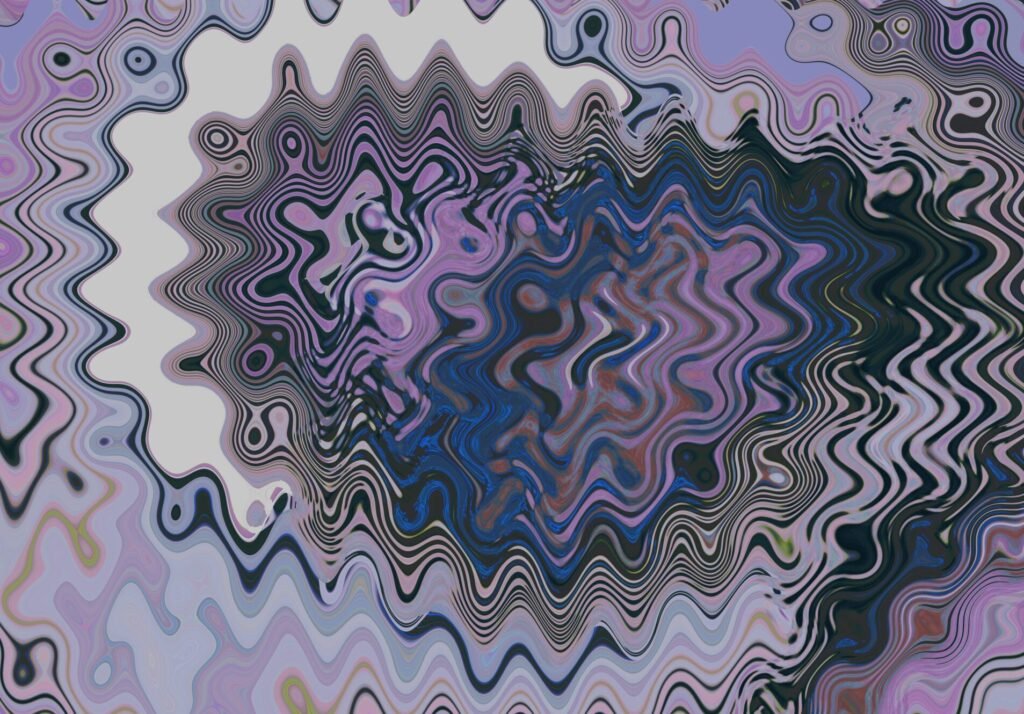
LOL V. STEIN : HÉROÏNE DE LA TRANSPARENCE
LITTÉRATURE
LILA DOUSSON
Lire Marguerite Duras, c’est traverser un corps romanesque disloqué, fuyant, un récit en creux où chaque mot s’approche d’une figure qui s’efface au moment d’apparaître. Lol V. Stein n’occupe pas l’intrigue : elle la perfore.
La protagoniste ne se constitue pas comme un sujet plein, elle se construit comme une lacune agissante — un trou noir narratif qui attire les voix, les temps, les regards. Cette puissance d’absorption ne dit pas la passivité ; elle indique un mode d’existence par intermittence, une liberté paradoxale : être là en se soustrayant, dicter au récit sa grammaire par sa manière de s’effacer. Cette logique du manque n’est pas un effet de style : c’est le cœur de l’expérience durassienne, où disparition et vacillement du sens s’engendrent réciproquement.
Avec Lol, Duras sabote les cadres de la littérature classique : la narration ne progresse pas, elle bégaie, revient, répète, reprend. Jacques Hold – narrateur masculin – croit s’approprier l’histoire là où Lol par son être, par sa voix manquante, décompose sporadiquement l’histoire et réussit à la faire sienne. Le roman s’effiloche au contact de cette femme qui ne dit pas « je », ou plutôt, dont le « je » ne cesse de se déliter.
Lol ne se présente pas, elle se retire ; elle n’entre pas dans le récit, elle le dissout. Elle est l’absence qui ronge le tissu narratif, la faille par où s’engouffre le texte.
« À travers la transparence de son être incendié, de sa nature détruite, elle m’accueille d’un sourire. »
LA SCÈNE VIDE : UN DISPOSITIF ET NON UN DÉCOR
Tout commence et ne cesse de recommencer au bal de T. Beach : événement-noyau, traumatisme et matrice. Lol voit son fiancé, Michael Richardson, se détourner d’elle pour partir avec une autre femme, Anne-Marie Stretter. Elle reste figée, spectatrice impuissante de la scène de rencontre qui l’exclut définitivement ; ce moment, jamais vraiment dépassé, devient le nœud autour duquel tout le roman se recompose, entre mémoire, répétition et obsession.
« Lol resta toujours là où l’événement l’avait trouvée lorsque Anne-Marie Stretter était entrée, derrière les plantes vertes du bar. »
Il ne faut pas lire cette scène comme une simple origine diégétique – c’est-à-dire un point de départ narratif interne à l’histoire – mais comme un dispositif. Le regard ne trouve pas de point fixe, l’objet observé (le couple Michael Richardson / Anne-Marie Stretter) se dérobe, le sujet regardant (Lol) ne s’affirme pas, et même le narrateur devient pris dans le regard de Lol en racontant cet événement auquel il n’a pas assisté. Lol est constituée dans et par cette scène, dans l’écart, l’espace laissé par la perte, elle est produite par une faille.
C’est la « scène vide »¹ : non pas l’opposition d’un observateur et d’un objet, mais la mise en place d’un champ de manque — le lieu d’un regard sans propriétaire. Cette vacance structure la narration : elle déplace l’action vers la répétition, substitue à l’enchaînement causal une dérive de retours, de variantes, de points de vue contaminés. C’est là que l’écriture se durassianise : par l’installation du vide comme moteur.
Dans cette scène, l’absence fait œuvre : elle aimante et elle ordonne. Le texte revient au bal comme on revient au rêve : non pour l’expliquer, mais pour mesurer l’écart qu’il ouvre dans la parole. La construction de Lol par Jacques Hold (et à travers lui par le roman) relève alors d’une anamnèse fantasmatique² : la représentation multipliée d’un objet déjà perdu qui ne cesse de fonder le récit tout en l’invalidant. D’où l’impression que l’on peut avoir, à la lecture, d’un roman sans récit : la narration n’additionne pas des faits, elle rejoue inlassablement un manque.
CORPS BLESSÉ ET FÉMININ EN NÉGATIF
C’est à partir de ce manque originel qu’a pu être construite toute une pensée psychanalytique du personnage de Lol V. Stein. Lire Le Ravissement avec Lacan, c’est d’abord entendre le double sens du titre : être « ravi », c’est être saisi (en extase) autant qu’être enlevé (dépossédé).
La scène du bal « enlève » Lol à elle-même, mais cet arrachement produit un nouveau régime d’être : un sujet défini par ce qui lui manque. C’est là que résonne la logique du regard chez Lacan : ce n’est pas ce que je regarde qui fait sujet, mais ce par quoi « ça me regarde » ; non pas l’œil souverain de Jacques Hold, mais le piège où son désir se prend. Le roman exhibe ainsi la subversion du regard masculin : celui qui parle croit posséder l’histoire et se découvre raconté par elle.
Cette lecture éclaire l’obsession du texte pour les postures de guet, les scènes d’observation, les « mises en vue » : le voyeurisme n’est plus un motif, mais une structure éthique du récit. Qui a le droit de voir ? Voir est-il toujours dérober ? Les travaux récents sur Lol V. Stein creusent cette dissymétrie entre le regard illégitime des personnages (le narrateur Jacques Hold, parfois Lol elle-même lorsqu’elle épie Tatiana) et la position du lecteur, sommé d’assumer un regard « juste » sur l’invisible. Le roman devient laboratoire du voir : ce n’est pas l’objet qui se dérobe, c’est l’appareil de vision qui se défait.
« Cet instant d’oubli absolu de Lol, cet instant, cet éclair dilué, dans le temps uniforme de son guet, sans qu’elle ait le moindre espoir de le percevoir, Lol désirait qu’il fût vécu. »
Le Ravissement de Lol V. Stein n’est pas seulement l’histoire d’une pathologie – Lol absente, Lol ravie ; ce qui se joue, c’est une véritable poétique de la disparition. Le corps féminin, dans la littérature du milieu du XXe siècle, est toujours balancé entre divers clichés : sensualité, maternité, désir offert ou refusé… Duras refuse la case et propose une héroïne dont la féminité se déploie en négatif. Lol est un trou béant, un vide actif qui absorbe les mots des autres, qui aspire les regards et défait les structures narratives. Elle ouvre une brèche dans le récit au masculin et ne prend pas la parole au sens classique, elle ne revendique pas frontalement — elle opère par intermittences, par effacements et par infiltrations. C’est l’ellipse comme liberté qui pénètre la narration et la transperce.
Jeremy Kasten parle ainsi d’écriture du corps blessé³ : l’abjection, l’atteinte, la marque — non pour pathologiser le féminin, mais pour dire une éthique du sensible. Le roman recadre la souffrance en puissance d’interruption ; loin de la figure victimaire, Duras fait de cette blessure une contre-esthétique : un art de ne pas coïncider.
« Ses cheveux avaient la même odeur que sa main, d’objet inutilisé. Elle était belle mais elle avait, de la tristesse, de la lenteur du sang à remonter sa pente, la grise pâleur. »
L’ouvrage Reinscribing the Wounded (Female) Body in The Ravishing of Lol V. Stein analyse le roman de Marguerite Duras à travers le prisme du corps féminin blessé, en particulier dans sa dimension psychologique, émotionnelle et symbolique. Jeremy J. Kasten s’intéresse à la manière dont le traumatisme de Lol V. Stein, provoqué par l’abandon amoureux, se traduit par une blessure corporelle métaphorique. Le corps de Lol devient ainsi un lieu d’inscription du traumatisme, de la mémoire, mais aussi d’une tentative de résistance et de reconstruction identitaire. Marguerite Duras met en place des procédés narratifs qui lui permettent de dépeindre un corps féminin à la fois aliéné et subversif : Lol incarne un corps absent-présent, dont les silences, les errances et les gestes traduisent une douleur impossible à verbaliser mais inscrite dans sa chair. Elle orchestre une réécriture du féminin, où la subjectivité de Lol se recompose en dehors des cadres traditionnels du désir et de la représentation masculine. C’est le corps comme interruption de la parole narrative et du récit : la blessure n’est pas pathologisée par le féminin, mais elle rompt la continuité et rend visible une autre syntaxe du vécu. Le corps féminin devient à la fois victime, lieu de mémoire et moyen de re-signification face à la domination narrative et sociale.
POLITIQUE DE LA VOIX MANQUANTE
Le geste de Marguerite Duras n’est donc pas uniquement esthétique : c’est une dissidence. L’autrice sabote les cadres : narration trouée, focalisations instables, scènes qui ne « servent » pas l’intrigue, voix féminine privée d’elle-même — et c’est justement par cette privation que le roman fait place à un féminin non assignable. Elle invente un espace où ne pas coïncider devient en soi un acte. Le langage porte la marque de cette dislocation et fait du manque la matière concrète qui empêche la voix de Lol.
« Manquant, ce mot, il gâche tous les autres, les contamine, c’est aussi le chien mort de la plage en plein midi, ce trou de chair. »
Lol existe là où d’autres parlent (pour, contre, autour d’elle). Ce n’est pas seulement l’effet d’un « je » masculin qui confisque la parole, c’est la loi du texte : Lol se fabrique dans et par l’énonciation d’autrui.
La modernité de Duras tient ici à une invention de la forme intermittente : un récit qui se dilate et se retire, comme une respiration. L’héroïne apparaît, puis se défait en transparence. L’« ultra-féminin » (silhouette, grâce, souffle) n’est jamais stable ; il est repère fugitif, contrebande de signes, manière de passer à travers sans s’y laisser prendre. Comme une anti-Emma Bovary, là où Flaubert construit son héroïne dans le trop-plein — trop de désirs, trop de lectures, trop d’attentes –, Duras creuse et allège. Lol est une Bovary retournée : non pas saturée de romanesque mais dépouillée jusqu’à l’os. L’héroïne construit l’histoire par son manque constitutif, comme un « hors-sens » dans le récit masculin.
Le roman ne se comprend pas « malgré » ses blancs ; il se comprend par eux. C’est pourquoi il n’y a pas de « diagnostic » final de Lol, mais des lignes de force. C’est la reconstruction de l’existence féminine qui s’infiltre entre les mots, une réécriture du récit par le silence subversif.
- Laurence Bougault, Incipit du Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras : reflet d’un roman anti-narratif, Université Rennes II
- Stéphane Lojkine, « Dispositif de la scène vide dans Le Ravissement de Lol V. Stein », Cahiers Marguerite Duras, n° 3, 2023, Université d’Aix‑Marseille, Université de Lille, mis en ligne le 1er juin 2024
- Kasten, J. (2014) “’Écriture féminine, écriture traumatique’: Reinscribing the Wounded (Female) Body in ‘The Ravishing of Lol Stein’”, Dandelion: Postgraduate Arts Journal and Research Network.
