NUMÉRO 1 : LE VIDE
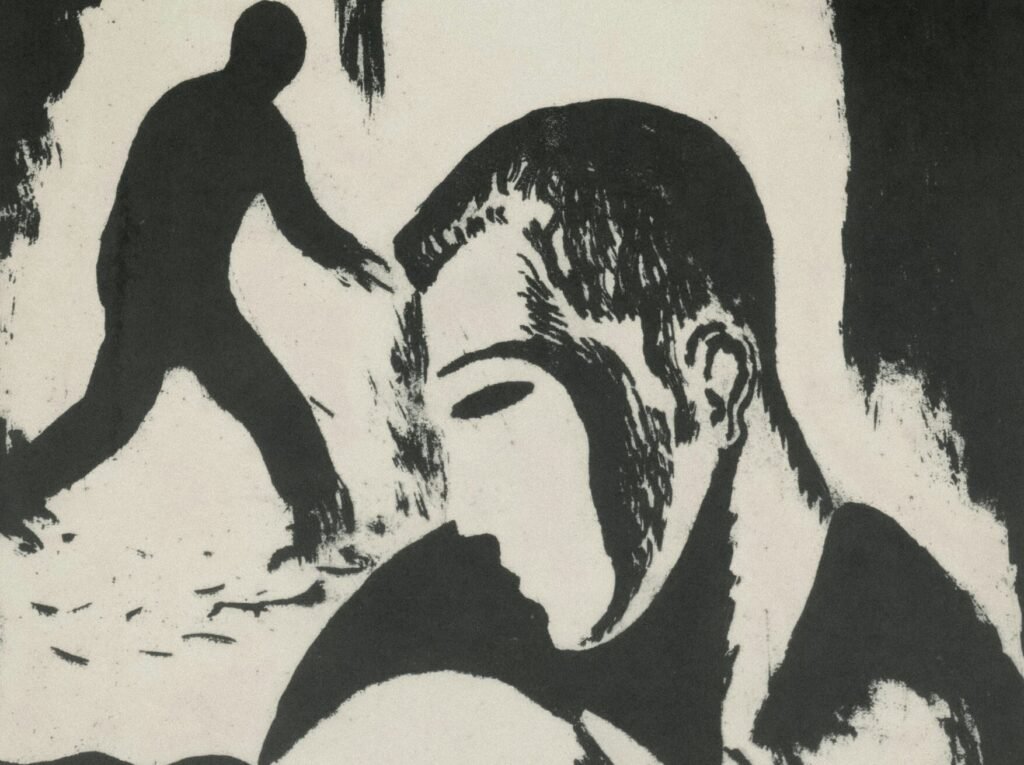
SUICIDE DES HOMMES : QUAND LA MASCULINITÉ CONSTRUIT SA PROPRE CRISE ?
ANALYSE
NELL GALLAIS
L’argument est providentiel : pour rejeter en bloc l’existence même du patriarcat, les masculinistes brandissent en étendard les statistiques – au demeurant inquiétantes – du suicide des hommes. Pour eux, le constat est sans appel : si les hommes se suicident plus que les femmes, c’est donc qu’ils vont plus mal qu’elles. De là à nier l’existence d’une oppression genrée en défaveur des femmes, il n’y a qu’un pas, allègrement franchi par les figures de proue du mouvement masculiniste, en France comme aux États-Unis. Il n’est même pas rare de les entendre parler de sexisme inversé, et affirmer que si violence de genre il y a, c’est sur les hommes qu’elle se porte. La dernière étape du raisonnement consiste à blâmer les féministes pour la « crise de la masculinité », que ces lanceurs d’alerte improvisés utilisent à tort et à travers sans jamais chercher à comprendre ce que désigne cette notion. La boucle est alors bouclée : les hommes vont mal, plus mal que les femmes, et c’est à cause des femmes.
Rappelons tout de même que le suicide n’est pas le seul marqueur de mal-être : la dépression et les maladies psychiques en général, le stress et l’anxiété, les troubles du comportement alimentaire ou du sommeil, les actes auto-destructeurs en sont autant de signes pour lesquels les hommes ne sont pas spécialement surreprésentés. Mais en ce qui concerne le suicide, c’est indéniable, et de fait assez inquiétant. Selon l’Organisation mondiale de la santé, « plus de deux fois plus d’hommes que de femmes mettent fin à leurs jours, avec un taux de 12,6 pour 100 000 hommes contre 5,4 pour 100 000 femmes¹» en 2019. En France, entre janvier 2020 et mars 2021, l’Observatoire national du suicide a dénombré « 11 210 décès par suicide, dont 75% concernent des hommes »². Ces chiffres sont presque exactement les mêmes en Amérique du Nord. Jordan Peterson et consorts ont raison sur un point : ces statistiques sont édifiantes, et l’écart est tel que l’on ne saurait y voir un hasard. Mais ils ont tort sur tout le reste, et le consensus scientifique offre de toutes autres explications que les interprétations des masculinistes.
Ce qu’il faut d’abord dire, c’est que si le taux de suicides effectifs est largement plus élevé chez les hommes, ce sont les femmes qui sont surreprésentées dans les chiffres des tentatives de suicide, et de loin. Selon le site de la ligne téléphonique d’urgence suicide, le 3314, « en 2017, 7,2 % des personnes de 18-75 ans ont déclaré avoir tenté de se suicider au cours de leur vie, la prévalence étant plus élevée chez les femmes (9,9 %) que chez les hommes (4,4 %)»³. Même si l’on considère que certains cas ne sont pas recensés, les séjours hospitaliers suite à une tentative de suicide concernent en particulier les jeunes femmes de 15-19 ans (en moyenne 41 pour 10 000) et de 45-49 ans (en moyenne 29 pour 10 000). Cette curieuse inversion statistique connaît de multiples explications. Un article de Libération de 2018⁴ choisit la plus simple et la moins révélatrice : les hommes utilisent tout simplement des armes plus létales. C’est en effet le cas, en particulier aux États-Unis où la détention d’armes à feu est généralisée mais toujours très masculine, tandis que les femmes ont plus souvent recours à des méthodes moins radicales, notamment l’ingestion de substances toxiques, médicaments ou autres. Mais cette interprétation est désespérément pauvre au regard de la multiplicité des facteurs qui expliquent vraiment cet écart.
Un article plus récent de FranceInfo⁵ met l’accent sur un facteur déterminant : la tendance plus naturelle des femmes à chercher de l’aide, auprès de leurs pairs et/ou de professionnel·le·s de santé. Le psychologue interviewé souligne que « les hommes, bien souvent, vont prendre en compte le problème tard, voire trop tard ». Ainsi, on assiste à un nombre important de tentatives de suicide chez des femmes qui cherchent surtout à lancer un appel à l’aide, et vont, à partir d’une première tentative, majoritairement faire en sorte que cet appel soit entendu. Elles sont donc moins promptes à la récidive, car ces premières tentatives fonctionnent comme des sonnettes d’alarme qui les encouragent à mettre en place des stratégies pour aller mieux. Les hommes ont plutôt tendance à s’en remettre à ce geste en dernier recours, et de manière beaucoup plus définitive. Les chercheuses québécoises Lucie Charbonneau et Janie Houle, dans une étude de 1999 qui n’a rien perdu de son actualité, vont même plus loin. Pour elles, les hommes font beaucoup moins de tentatives de suicide qui n’aboutissent pas car la seule chose qui est plus mal vue socialement pour les hommes que de se suicider, c’est de tenter de le faire sans y parvenir⁶. Les hommes auraient si peur des conséquences sociales d’une tentative de suicide (apitoiement et misérabilisme de leur entourage, ou tout simplement conscience que quelque chose ne va pas) qu’ils vont, de fait, utiliser des moyens plus létaux pour plus de certitude. Le problème, c’est donc d’assumer socialement un mal-être, première étape vers une prise en charge que beaucoup d’hommes perçoivent comme diminuante.
Le cœur du problème est donc la socialisation masculine, que toutes les études pointent comme le facteur le plus aggravant pour cette asymétrie statistique, et de loin. Lucie Charbonneau et Janie Houle établissent une liste utile d’éléments qui expliquent cette inégalité, en distinguant d’une part les facteurs aggravants qui pèsent sur les hommes et d’autre part les facteurs qui inhibent la protection, la recherche d’aide et la prise en charge collective d’un mal-être psychique masculin. Dans la première catégorie, on trouve la surreprésentation des comportements à risque chez les hommes, avec en tête la consommation d’alcool, largement inégalitaire (selon Santé Publique France, en 2021, 50,5% des hommes consommaient de l’alcool chaque semaine, contre 28,2% des femmes)⁷. Ce n’est pas que ces comportements à risque augmentent la probabilité de mettre fin à ses jours, c’est plutôt qu’ils prennent souvent la forme d’une automédication face à des situations de détresse psychologique. Sous couvert d’“oublier leurs problèmes”, les consommateurs excessifs les repoussent avec l’aide des substances, ce qui aggrave considérablement le risque que ces difficultés ne deviennent de plus en plus ingérables à mesure qu’elles sont ignorées. Ces excès vont dans le sens d’une socialisation masculine de l’évitement : que la consommation se fasse seul à la maison ou bien dans des cadres sociaux, il s’agit à chaque fois de ne pas parler de ce qui ne va pas et de créer artificiellement un cadre festif qui donne l’illusion momentanée que les difficultés sont surmontées. Et si l’alcool désinhibe, s’il peut offrir l’occasion de se confier dans le cadre de ces sociabilités masculines peu tournées vers l’expression des émotions, ces moments de vulnérabilité sont justement mis sur le compte de l’alcool et ne fonctionnent que très rarement comme des sonnettes d’alarme. L’alcool (ou tout autre substance), sous couvert de créer un espace d’honnêteté ou de permettre un relâchement des barrières sociales, crée en réalité une dimension dans laquelle un problème pourra être exprimé librement mais départi de sa gravité, pour mieux l’ignorer par la suite.
Il y a d’autres facteurs aggravants, mais ils sont moins probants, en bonne partie parce qu’ils sont partagés avec les femmes, comme l’homosexualité refoulée que les chercheuses citent en exemple, qui concerne tous les genres même si elle peut entraîner une dissonance cognitive plus forte chez les hommes pour lesquels l’homophobie internalisée est souvent plus prononcée. Citons aussi les conditions de travail délétères qui poussent les travailleurs à bout (on pense à l’affaire France Télécom), mais à mesure que les femmes ont des emplois salariés au même titre que les hommes, il n’y a pas de grande disparité de ce côté (à l’exception des agriculteurs, corps de métier majoritairement masculin et dont le taux de suicide est de plus en plus alarmant). Mais au fond, ce qui explique la surreprésentation du suicide chez les hommes, ce sont moins ces facteurs aggravants que les facteurs d’inhibition de la protection et de la prévention que citent les chercheuses. En effet, toute tentative d’aide à une personne en difficulté entre en conflit radical avec les représentations classiques du masculin. On a déjà évoqué le mutisme des sociabilités masculines, mais il faut le souligner : l’écoute, la mise en valeur de l’émotion et de la vulnérabilité, l’échange sont des caractéristiques stéréotypiquement féminines, et non seulement les hommes mettent beaucoup moins l’accent sur elles que les femmes, mais ils perçoivent souvent ces comportements comme dégradants, révélateurs de faiblesse, ou tout simplement inenvisageables pour eux. Comme le mal-être n’est jamais (ou rarement, ou pas de manière efficace) exprimé dans la sphère sociale, il n’est jamais pleinement reconnu, ni par ses pairs ni par soi-même ; en d’autres termes, on ne peut pas soigner un mal dont on n’a pas reconnu qu’il existait. Mais cette reconnaissance est très difficile à mettre en place seul, en particulier pour les hommes, qui sont beaucoup plus sujets à la honte de ne pas “assurer” : cette tendance au secret et à la dissimulation des blessures devrait pousser l’entourage (masculin) de chaque homme à redoubler d’efforts pour faire émerger ces difficultés, les rendre communicables, mais c’est tout le contraire qui se produit.
Le site internet d’Allô docteurs qualifie la santé mentale des hommes de « crise silencieuse», et c’est en effet l’impression que l’on a lorsque l’on décrit cette incommunicabilité du mal-être masculin, mais l’appellation a quelque chose de fallacieux. En effet, la « crise silencieuse »⁸, ce n’est pas la santé mentale des hommes mais la santé mentale en général. La crise du Covid-19 a mis en lumière l’inaction, voire l’incompréhension des pouvoirs publics envers ce qui est souvent perçu comme un “mal du siècle”, simplement parce que les jeunes générations évoquent ce sujet beaucoup plus que leurs aînés. La prise en compte des problèmes de santé mentale ne va pas vers le meilleur ; il n’y a qu’à voir les mesures prévues par le Premier ministre britannique Keir Starmer, coupes budgétaires drastiques dans un NHS déjà vacillant, qui mettent en valeur la perception de la santé mentale comme une fausse maladie⁹. Face à la polémique, Starmer a affirmé que le gouvernement « soutiendrait bien sûr ceux qui en ont besoin, mais aiderait ceux qui peuvent travailler à le faire », déclaration doublement discutable puisque d’une part elle sous-entend qu’à l’heure actuelle aucune des personnes qui bénéficient de l’aide de l’État à cause de problèmes de santé mentale ne travaillent (alors qu’au moins un tiers des Britanniques travaillent même dans ce cas), et d’autre part elle ne dit pas quels critères sont choisis pour déterminer si une personne peut travailler ou non. On a, là encore, une négation de la maladie mentale comme problème de santé publique, systématiquement associée à une exagération, ou pire, un caprice. Tout le pays souffrira de ces coupes budgétaires, comme en alerte le corps médical, mais ce sont bien sûr les franges les plus pauvres de la population qui verront leurs problèmes de santé au mieux repoussés dans des listes d’attente interminables, au pire niés. Ce climat participe à faire de la santé mentale une « crise silencieuse », et si beaucoup d’hommes en pâtissent, c’est parce que ce silence est déjà un élément structurel de leurs sociabilités, là où les femmes entre elles ont davantage tendance à le conjurer. Tout le monde est donc logé à la même enseigne en termes de droits sociaux, mais beaucoup d’hommes ne bénéficient même pas d’un espace où ce manque peut s’exprimer.
L’accent mis par Keir Starmer sur le travail n’est en rien anodin. Il révèle évidemment à quel point la rentabilité prévaut sur les droits des travailleurs, mais il met aussi l’accent sur les dynamiques qui rendent les hommes plus vulnérables au suicide. Comme le montrent Lucie Charbonneau et Janie Houle, « la validation sociale par le travail est supérieure pour les hommes », même si ce déséquilibre a tendance à s’amoindrir au fil des décennies. Cela crée une pression sociale non négligeable : Allô Docteurs remarque que « dans les raisons associées aux pensées suicidaires, les femmes mettent majoritairement en avant des raisons dites « familiales », là où les hommes les lient plus souvent au « travail » ». On observe d’ailleurs facilement une corrélation entre le taux de chômage et le taux de suicide, particulièrement masculin. La capacité à « subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille » est un enjeu crucial de la masculinité, et de fait, lorsque cette capacité n’est plus jugée satisfaisante, cela devient un facteur très aggravant pour des crises psychiques qui, comme on l’a dit, ne sont souvent pas prises en charge, ou trop tard. Mais ce que l’on remarque aussi nettement, c’est un « parallèle entre l’augmentation des taux de divorce et de suicide masculin ». Les chercheuses montréalaises expliquent ce phénomène par le fait que ce sont le plus souvent les femmes qui obtiennent la garde majoritaire des enfants (quoique cette disparité ait elle aussi tendance à diminuer) ; en plus de cette garde, elles ont également des structures sociales, notamment familiales, plus implantées, qui leur permettent de faire face à un divorce en étant plus entourées. Donc les hommes souffrent davantage de l’injonction à subvenir aux besoins de leur foyer, mais lorsque le foyer se sépare et que cet enjeu n’est plus aussi prégnant, ils se retrouvent dans une situation tout aussi précaire puisqu’aux sentiments d’inutilité et surtout d’échec (familial, affectif, échec d’une représentation sociale performante) s’ajoute un sentiment de solitude face à leurs propres problèmes. Notons également que dans le couple hétérosexuel, c’est généralement la femme qui a pour tâche d’assurer les liens sociaux avec la famille étendue ou avec certains groupes d’amis : beaucoup d’hommes ne sont jamais mis face à l’effort qu’impliquent le renouvellement et l’entretien de sociabilités salvatrices (tant dans le soutien émotionnel que dans l’aide matérielle). Les chercheuses affirment que « les hommes sont donc largement dépendants de leur conjointe pour satisfaire leurs besoins affectifs et maintenir leur santé psychologique et physique ». Donc en l’absence de celle-ci, tout s’écroule, semble-t-il.
Or, le soutien apporté par les femmes à leur conjoint dans le couple n’est pas valorisé non plus. Absolument tous les sites de prévention, notamment ceux qui fleurissent dans le cadre du mouvement Movember (qui vise à sensibiliser sur le cancer de la prostate mais aussi sur la dépression masculine), affirment que pour régler le problème du suicide des hommes, il faut encourager une « pression sociale positive par les pairs », c’est-à-dire normaliser l’échange autour de la santé mentale et le fait de proposer de l’aide sans attendre que la personne qui souffre ne la demande d’elle-même. L’idée qui semble faire consensus, c’est que ce sont les hommes entre eux qui sont « les plus à même de susciter une libération de la parole autour des problèmes de santé mentale»¹⁰. En d’autres termes, les hommes dépendent factuellement des femmes de leur entourage (en particulier de leur conjointe) pour assurer la satisfaction de leurs besoins émotionnels, mais cela ne suffit jamais, ni pour prévenir un problème de santé mentale, ni pour le conscientiser, ni pour tenter de le régler une fois qu’il est avéré. C’est le paradoxe de la socialisation masculine : même dans le cadre des relations où l’émotion est privilégiée (c’est-à-dire les relations avec des femmes), l’émotion reste l’apanage du féminin. Cela renvoie à la figure de l’homme protecteur, mais pas seulement, puisque l’homme se pense comme protecteur avant tout matériellement, en particulier pour subvenir aux besoins économiques d’un couple et pour protéger sa conjointe contre d’autres hommes. Une femme dans un couple n’est pas seulement la gestionnaire de la part affective et émotionnelle de la relation, elle en est l’unique dépositaire et, en fait, l’unique objet. S’il n’est certes pas souhaitable que les femmes prennent entièrement en charge les besoins des hommes en termes de santé mentale (c’est d’ailleurs pour éviter cela que la communication au sein de groupes d’hommes est encouragée par les spécialistes), il est tout de même notable que les femmes ne bénéficient même pas de la confiance des hommes dans les matières qui sont pourtant stéréotypiquement leur spécialité voire leur fonction, à savoir tous les actes que l’on regroupe sous le terme général de “care” et qui sont les plus déterminants en termes de santé mentale. Ce qu’il faut comprendre pour approcher le problème de la santé mentale des hommes, c’est que tout ce qui relève du “care” est décrié par eux, car perçu comme féminin : quand les femmes s’en chargent, ce n’est pas valable car ce sont des femmes, quand les hommes, par extraordinaire, s’en chargent, c’est risible car c’est un truc de femmes.
Les fameux influenceurs masculinistes répondent à ce paradoxe d’une curieuse manière : on trouve chez eux une volonté de se réapproprier le “care”, mais en le masculinisant en quelque sorte. Il ne s’agit jamais de prendre soin les uns des autres, entre hommes mais collectivement ; chez eux la part belle est faite au “selfcare”, selon de nouvelles modalités. On est évidemment loin d’Audre Lorde qui définit le “selfcare” comme un ensemble d’actes radicaux de préservation de soi face à la violence politique, mais il ne s’agit pas non plus de prendre un bain moussant en écoutant de la musique détente : chez les masculinistes, le “selfcare” devient une forme de mégalomanie axée sur le perfectionnement de soi et l’écartement de la moindre faiblesse. Très ancrées dans un univers d’entrepreneuriat avec pour modèles des pseudo-”self-made men”, ces injonctions à “devenir la meilleure version de soi-même” sont individualisantes et érigent l’homme fort et indépendant comme idéal suprême. On peut alors s’accomplir entièrement par le sport et le travail, qui conjurent le mal-être par la seule force de la volonté. La vidéo du YouTubeur sport Tibo InShape, dans laquelle il brame la désormais célèbre injonction “rien à foutre de ta dépression !” à son très jeune public par là même taxé de faiblesse, en dit long sur l’incompréhension de ce que signifie vraiment la santé mentale chez ces masculinistes. On pourrait les croire inoffensifs, mais la popularité croissante de ces figures érigées en modèle à la suite de l’Américain Andrew Tate n’est pas sans rapport avec une percée inquiétante des opinions misogynes et conservatrices chez les jeunes hommes. Cette fausse manière de prendre soin de soi souligne en négatif ce que nombre de thérapeutes recommandent pour encourager les hommes à admettre leur mal-être : alors que l’objectif est d’habitude la responsabilisation du patient, les spécialistes estiment qu’il est souvent nécessaire d’aller vers les hommes directement, et de leur faire prendre conscience frontalement de la réalité de leurs difficultés comme premier pas vers l’amélioration. La responsabilisation ne vient alors que dans un second temps, lorsque la première prise de conscience est effective.
Cette approche du soin est en opposition radicale avec les modalités du faux selfcare masculiniste. Celui-ci repose sur l’idée d’une résilience collective tacite, dont le principe cardinal est la loi du silence : l’appartenance au collectif — l’identité masculine en général ou la communauté d’un influenceur en particulier — suffit pour faire groupe et faire corps¹¹. Il n’y a plus de communication nécessaire, et tout affect individuel est nié car subsumé par l’ethos masculin collectif. Lorsque l’on appartient à la « Team Shape », il est peu nécessaire voire malvenu d’exprimer un mal-être ou des souffrances, puisque l’instance collective et rassembleuse est un marqueur identitaire suffisant, au sein duquel les spécificités sont tues, les décalages, effacés, pour tendre vers une masculinité essentialiste, hégémonique et homogène. Lorsque les masculinistes parlent de « crise de la masculinité », ils veulent dire que les hommes, brimés par les féministes, ne peuvent plus accomplir pleinement leurs fonctions familiales et sociales, et sont réprimés dans leurs libidos — sentiendi et dominandi. Or, s’il y a crise, elle est en interne : dans ces cercles du mutisme où l’enjeu est de tendre vers un idéal masculin assigné, les particularismes s’effacent, les doutes s’expriment difficilement, les manquements sont fustigés. Dans ces contextes normativisés, l’agressivité laisse souvent la place à une forme de négligence non moins destructrice ; le masculin ayant été essentialisé et brandi en étendard, tous les membres du groupe aspirent à la même chose, et c’est sur cette connivence tacite et assénée que le silence repose. Les femmes ne peuvent pas grand-chose à cette affaire : elles ont beau être les auditrices majoritaires des podcasts sur les masculinités comme Les Couilles sur la table (60%), et se préoccuper de cette « crise de la masculinité » en fait davantage que les hommes, c’est à eux qu’il appartient de résoudre les paradoxes dans lesquels le cercle fermé de la masculinité taiseuse qui « se sait » mais ne se parle pas les a enfermés. Or les spécialistes encouragent les proches des hommes en souffrance à faire le chemin vers eux, précisément parce que la masculinité toxique comme vase clos empêche l’accueil des souffrances et des difficultés émotionnelles. Pour résoudre cette crise bien réelle, les hommes doivent donc se parler entre eux, mais en conjurant résolument les dynamiques délétères que les cercles masculins ont structurellement tendance à reproduire ; surmonter ce paradoxe est une entreprise ardue, mais indispensable pour se sauver eux-mêmes.
« Un décès sur 100 est un décès par suicide », communiqué de presse de l’OMS, 12 juin 2021.
« Suicide : mesurer l’impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 – Effets contrastés au sein de la population et mal-être chez les jeunes », 5e rapport, septembre 2022, site de la DREES.
3114, Souffrance Prévention du Suicide, « Données chiffrées sur le suicide en France ».
« Pourquoi les hommes se suicident trois fois plus que les femmes ? », Jacques Pezet, Libération, 16 février 2018.
« Movember : il faut encourager les hommes, plus touchés par le suicide, à « demander de l’aide », plaide un psychologue », interview du directeur du Centre prévention du suicide de Paris Vincent Lapierre par Florence Morel, FranceInfo, 1er novembre 2023.
Charbonneau, L. & Houle, J., « Suicide, hommes et socialisation », Frontières, 12(1),1999, p. 62–68. Frontières est une revue québécoise de recherche et de mobilisation des connaissances en études sur la mort, et non pas le média d’extrême droite français éponyme.
Andler R, Quatremère G, Richard JB, Beck F, Nguyen-Thanh V. « La consommation d’alcool des adultes en France en 2021, évolutions récentes et tendances de long terme. », Bull Épidémiol Hebd. 2024.
« Pourquoi les hommes se suicident-ils plus que les femmes ? », Allô Docteurs, 13 juin 2019.
« Starmer urged to protect disability benefit claimants », Jennifer McKiernan et Harry Farley, BBC, 12 mars 2025.
FranceInfo, op. cit.
Voir Francis Dupuis-Déri, Crise de la masculinité. Autopsie d’un mythe tenace, Points Féministe, 2022.
